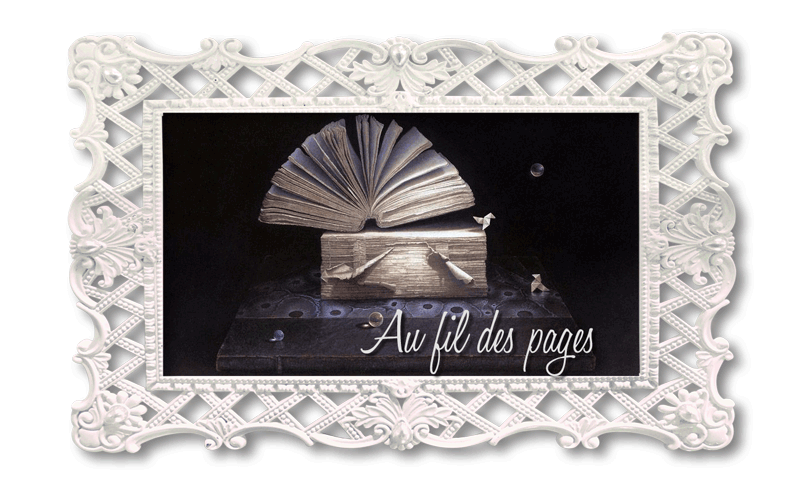Lui, c’est Oliver Barrett, IVème du nom, issu d’une riche lignée de prestigieux étudiants d’Harvard dont certains ont même donné leur nom aux bâtiments de l’université. Elle, c’est Jennifer Cavalleri, fille d’immigrés italiens, sans un sou. Ils se croisent à la bibliothèque et se chamaillent immédiatement: c’est le coup de foudre. Il est assez bête pour l’inviter à boire un café, elle est assez intelligente pour accepter. Malgré le désaccord de son père, il l’épouse. L’argent vient vite à manquer, mais ils font face: ils rêvent à leur premier enfant. Et pourtant, bientôt, il dira: « Que dire d’une fille de vingt-cinq ans quand elle est morte? ».
Difficile de résumer un livre si court sans en déflorer le contenu. En même temps, ce n’est pas franchement le contenu qui importe dans ce roman. Il n’est pas très original: deux amoureux que tout oppose, et notamment leur statut social. De Roméo et Juliette à Rose et Jack, on en a connu d’autres. En même temps, ce qui est bon dans cette histoire, ce n’est pas tant l’histoire, c’est la manière dont elle est racontée. Exit tout sentimentalisme, toute niaiserie, toute grande déclaration enflammée et relation torturée. Oliver et Jen se chamaillent gentiment dès le début. Placide et un tantinet sarcastique, elle l’appelle “Preppie” et le prend de haut. Pourtant, elle ira l’applaudir et lui criera “Fonce dans le tas!” pendant son match de hockey. Il lui déclare qu’il l’appellera peut-être dans dix minutes, ou peut-être pas avant plusieurs mois.
Racontée du point de vue d’Oliver, cette relation a donc cela de rafraîchissant que tout y paraît normal, naturel, simple. Et drôle. Et tendre. Il craint d’ailleurs de ne pas savoir parler d’amour autrement qu’en mots préfabriqués et trop usés ce qui lui attirerait immédiatement le mépris d’une fille aussi intelligente que Jenny. D’ailleurs, quand il décide de l’épouser et qu’elle demande pourquoi, il répond: “Parce que. –Ah! dit-elle, c’est une très bonne raison”. C’est en cela aussi que j’ai compris la célèbre phrase: “L’amour, c’est n’avoir jamais à dire qu’on est désolé". Le bonheur, finalement, c’est une chose simple et intelligente. Et l’émotion lorsque tout s’effondre n’en est que plus poignante: pas de passion intense, juste une vie normalement heureuse brisée. Et ça marche.
Et là où c’est très fort, c’est que malgré le petit nombre de page, le roman ne se contente pas d’explorer ce type-là d’amour. Aux rapports conflictuels d’Oliver avec un père qu’il juge trop blasé, qui attend de lui une perfection et une identification trop programmées, répond la piété familiale de Jen, très attachée à son papa. C’est aussi pour Oliver une recherche de soi, une déconstruction et une reconstruction de la famille. Est-ce par opposition à son père qu’il s’attache aussi vite et aussi fort à Jen? Ou lui son amour lui apporte-t-il la force de choisir sa famille et sa place comme il l’entend? L’histoire oscille souvent entre cette amertume contenue et cette douceur pleine de second degré. Je suis admirative d’arriver à provoquer tellement d’émotion avec autant de retenue et de sobriété.